Les garçons et les hommes blessés. La masculinité dans la culture américaine
READ IN ENGLISH | ЧИТАТЬ НА РУССКОМ
Traduction : Gauthier Nicolle-Chalot
Nous avons tous nos souffrances, nos blessures. Je n’ai jamais rencontré personne qui ait vécu une enfance de conte de fée. La douleur, les pertes et l’aliénation n’épargnent personne. Ce qui peut varier, toutefois, c’est la capacité des individus d’en parler à autrui ou même de se l’avouer. En tant que coach en développement personnel, j’ai été amené à constater que les hommes ont bien plus de difficultés à parler de leurs sentiments que les femmes. À vrai dire, dans la société américaine, la plupart des hommes n’ont sans doute jamais eu l’occasion de s’y entraîner.
Certains éléments de réponse peuvent être puisés dans les travaux des interculturalistes. Il y a quarante ans, Geerte Hofstede, un des premiers chercheurs interculturels et sociologue, a mesuré le niveau de masculinité des différents pays à travers le monde. Les États-Unis ont obtenu un score de 67 (sur 100), ce qui est élevé mais pas autant que, par exemple, le Japon (95). Une différence importante réside dans ce que Hofstede nomme dans la société japonaise « un collectivisme doux » qui représente un frein à une compétition ouverte. Ce qui fait le caractère unique des États-Unis sociologiquement parlant, c’est son score d’individualisme extrêmement élevé (91) qui, lorsqu’il est combiné avec un haut niveau de masculinité, crée une mentalité cruellement concurrentielle, celle du « the winner takes all ». Alors que cette culture motivée par la performance profitait à l’économie d’une nation en croissance, elle infligeait un coût social, celui de l’isolation et de la souffrance d’un grand nombre de jeunes garçons et d’hommes.
Traditionnellement, la plupart des jeunes hommes aux États-Unis ont peu de véritables modèles de rôles masculins ou même d’endroits où ils peuvent montrer leur vulnérabilité aux autres. J’ai grandi dans les années 1970 et à l’époque, les garçons « sensibles » étaient immanquablement moqués ou chahutés. Grandir au sein d’une culture qui a nourri les archétypes de cowboys et ceux des bandes dessinées (forts, peu bavards et ne comptant que sur eux-mêmes) rendait réticent, si ce n’est inquiet à l’idée de partager ses sentiments. Ces adolescents étaient sous la pression continue de se conformer à une certaine idée de la masculinité, bourrée de non-dits : « N’aie pas de sentiments ! », « Ne pleure pas ! » et surtout « Méfie-toi des autres hommes ». Ceux qui ne voulaient pas jouer le jeu ni essayer de rentrer dans le moule se retrouvaient soit ostracisés, soit s’isolaient. Plusieurs décennies plus tard, je me demande si la situation s’est vraiment améliorée.
Farrell n’est pas le seul spécialiste à avoir tiré la sonnette d’alarme à propos de ce malaise social grandissant. Ces dernières années ont vu nombre de psychologues participer aux talk-shows. Et ils clament tous le besoin vital des hommes de trouver une forme d’exutoire pour leurs émotions et de partager leur douleur avec autrui. Bien entendu, le premier et le plus important compagnon ou « pote » pour un jeune garçon est son père. Cependant trop de pères sont absents ou ressentent une gêne à l’idée d’une discussion ouverte avec leur fils. Probablement parce qu’ils se cantonnent au rôle qu’ils ont appris (inconsciemment) auprès de leur propre père.
Il est possible qu’une métaphore plus appropriée de la violence consisterait à la comparer à la mauvaise herbe d’un jardin : ses racines sont profondes et pas si faciles à extirper. Dans une culture du « the winner takes all » « le gagnant ramasse tout » ce sont les champions qui conservent ce pouvoir et l’affichent sans complexe. James Hollis, le célèbre psychanalyste jungien, est sans doute celui qui touche de plus près la racine du problème. Dans son œuvre Under Saturn’s Shadow: the Wounding and Healing of Men, il identifie le complexe du pouvoir à « la force centrale de la vie des hommes… qui les guide, qui les blesse et qui les pousse à blesser les autres. »
Une « page » pas facile à tourner et ce pour plusieurs générations à venir. Les archétypes ne sont pas modifiables facilement dans la programmation collective de l’esprit américain. Cependant, les efforts fournis pour éduquer les jeunes et créer une définition plus nuancée de ce que signifie « être un homme » les soulagera de la pression à se conformer à un idéal impossible. Certes, tous les « gagnants » ne sont pas des brutes, tout comme certains garçons peuvent ne pas vouloir ou ressentir le besoin de s’ouvrir aux autres… mais cette possibilité devrait exister pour ceux qui le désirent. De plus, les femmes comme les hommes ont besoin de s’exprimer sur les valeurs de compassion et d’intégration sans craindre d’être taxés de « mous » ou de « faibles ».
En tant qu’Américain, je suis d’un naturel optimiste. Je sais que c’est à notre portée. L’empathie pour la douleur des groupes, auxquels on ne s’identifierait pas habituellement ou spontanément, fait également partie des traditions américaines. Il faut commencer par tendre la main aux victimes de l’exclusion et engager un dialogue : d’enseignant à élève, de voisin à voisin, de mère à fille, de père à fils. Pas de textes, ni de tweets, mais d’authentiques conversations où l’on écoute avec sa tête et avec son cœur. Au début cela ne sera pas aisé, mais c’est un mal nécessaire. Comme je le disais, nous avons tous nos souffrances.
Si vous avez trouvé une faute d’orthographe, faites le nous savoir en sélectionnant ce texte et en appuyant sur Ctrl+Entrée.






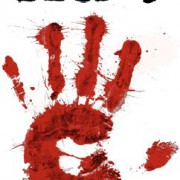
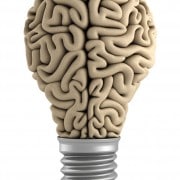

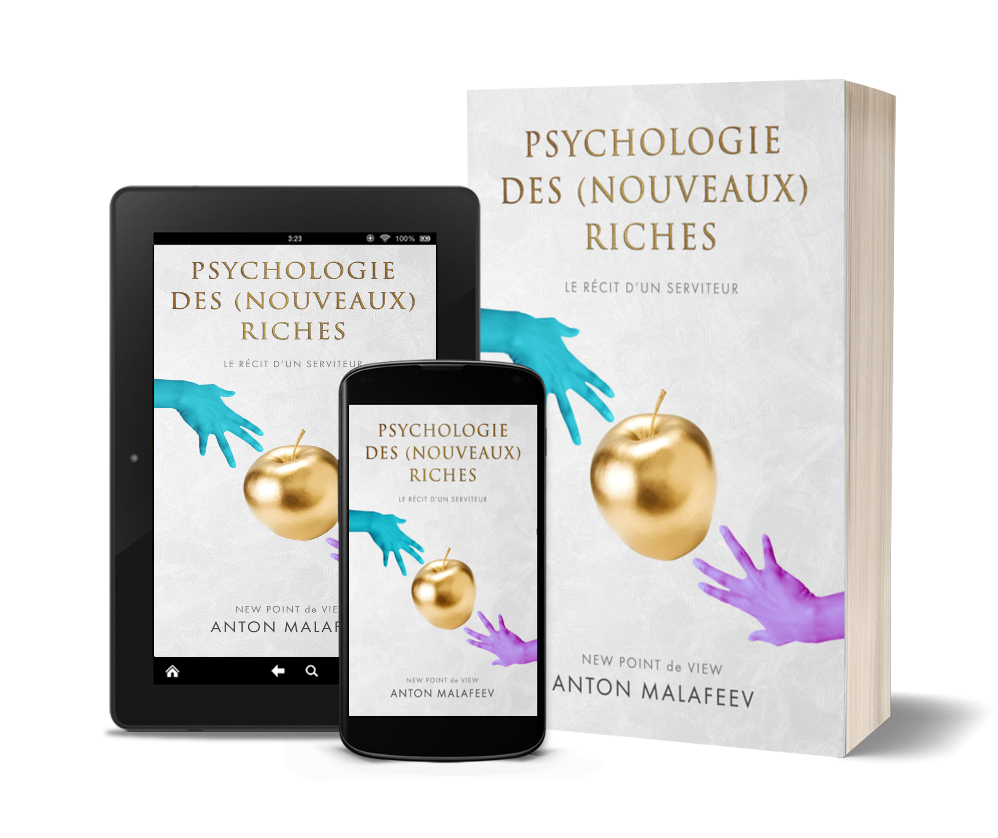
 Anton Malafeev
Anton Malafeev TOSHIO SAEKI
TOSHIO SAEKI
Bonjour Denis,
Je souhaiterai vous remercier pour la délicatesse de votre article sur la question du masculinisme qui est d’une réalité dès plus frappante. Dans un monde ou tout change, les êtres humains de sexe masculin sont aussi en train d’évoluer.
D’ailleurs, la question francaise est en cours comme le montre l’ouverture de ces 2 nouveaux podcast:
– Les couilles sur la table
– The boys club
Chacun ayant une approche differente :)
J’espère ainsi ajouter une petite pierre à la complexité du sujet.
Alex
Article très intéressant qui me fait personnellement réaliser l’importance qu’ont eu pour moi certaines personnes en me permettant justement d’extérioriser mes douleurs et frustrations par la parole (je ne parle pas de psys mais d’amis intelligents et empathiques).
Coïncidence ou non, j’ai arrêté la boxe quelques temps après avoir fait leur rencontre.
P.S. Je ne crois pas aux coïncidences.